Entretien avec un enfant du siècle : Kangni Alem, l’auteur d’«Un parfum de grenades lacrymogènes»

Prix Tchicaya U’Tamsi du Concours théâtral interafricain, Grand prix littéraire d’Afrique noire, l’écrivain, dramaturge et metteur en scène Togolais, Kangni Alemdjrodo (Kagni Alem) était à Libreville début août. L’auteur du roman à succès «Cola cola Jazz», s’est prêté aux questions de la rédaction. Il annonce, dans cet entretien, la mort du théâtre classique non sans souligner que «la forme évolue tout le temps et s’adapte aux réalités». On parle de la Revue Noire. On évoque Simon Njami, la chute du mur de Berlin, le suicide de l’écrivain japonais Yukio Mishima, l’homosexualité comme sujet de littérature, le théâtre radiophonique sur RFI, et bien d’autres choses qui ne son pas dans les livres. Échange passionnant avec un enfant de la fin du XXème siècle et jeune adulte du XXIème. (1ère partie)

Kangni Alem à la rédaction de Gabonreview (Libreville), le 4 août 2021, en compagnie de l’écrivain et diplomate gabonais Eric Joël Bekale-Etoughet. © Gabonreview
Gabonreview : Quelle carte de visite pouvez-vous rapidement décliner à ceux qui ne vous connaissent pas ?
Kagni Alem : Je me présenterais comme Alem… Alemdjrodo, un écrivain togolais et enseignant de littérature comparée et de théâtre, essentiellement à l’université de Lomé. Je crois que c’est la carte de visite la plus simple et la plus connue que je décline souvent à mes interlocuteurs.

Kangni Alem, homme de lettres, écrivain, traducteur et critique littéraire togolais. © Facebook
Mais encore… on a vu que vous vous intervenez dans d’autres universités ?
Avant la Covid-19, j’intervenais régulièrement à l’université du Vermont en Californie où je donnais des cours de théâtre. Et puis, je suis associé à mon ancienne université, l’université de Bordeaux, où j’ai vécu quand même pendant 12 ans et enseigné. Voilà ! Globalement, je suis un globetrotter. Je suis universitaire, dans beaucoup d’universités africaines et américaines.
Quand on cherche sur la toile mondiale, quand on regarde un peu, nombreux vous considèrent d’abord comme un homme du théâtre et vous êtes le fondateur d’un atelier à Lomé. Qu’en est-il réellement ?
Oui, c’est pour cela que tout à l’heure j’ai insisté sur ce que, moi, j’enseigne. Même si j’enseigne la littérature de façon générale, ma vraie passion c’est d’enseigner le théâtre. Mais le théâtre professionnel. Je n’enseigne pas le théâtre théorique. Pas du tout. Parce que j’ai eu un parcours classique. J’ai fait des études de littérature comparée à l’université de Bordeaux. Mais, j’étais également inscrit au conservatoire de théâtre de Bordeaux où j’ai appris à faire du théâtre. J’avais travaillé également à l’ancienne Troupe nationale du Togo où j’ai appris la mise en scène aux côtés d’un maître de théâtre qui s’appelle Sénouvo Agbota Zinsou, l’un des plus grands dramaturges togolais. Et quand j’ai commencé à écrire, c’était le théâtre, bien avant le roman : mes premiers succès ont été théâtraux.
En 1990, j’avais obtenu le Grand prix du concours théâtral inter Africain Tchicaya U’Tamsi. Je me suis donc très tôt investi dans la pratique théâtrale. Je considère, c’est ce que j’enseigne, que le théâtre aujourd’hui a beaucoup évolué. Au-delà du simple plaisir qu’une représentation théâtrale peut donner, la plupart des professionnels du théâtre insistent sur le côté pédagogique et multidisciplinaire du théâtre.
Avec les étudiants par exemple, nous faisons des interventions dans les cliniques auprès d’enfants cancéreux. Des enfants de 5, 6, 7 ans, atteints du cancer, à qui nous apportons une leçon de vie à travers le rire. Utiliser les techniques du clown pour faire oublier et montrer à un enfant malade, ne serait-ce que trente minutes, qu’il y a une autre vie ailleurs qui se passe dans l’imaginaire. On peut utiliser le théâtre, nous l’avons expérimenté, dans des collèges de Lomé. On peut utiliser le théâtre de façon médiatique pour enseigner à des élèves ayant des difficultés en mathématique, par exemple, des concepts mathématiques que l’on ramène dans des exercices de théâtre, dans l’espace.
Vous savez, le théâtre c’est aussi de la géométrie. Quand vous voyez un acteur se déplacer, il ne se déplace jamais au hasard. Il y a quelqu’un qui lui a tracé le déplacement dans la mise en scène. Les figures géométriques, qui sont la base des mathématiques, sont aussi le travail du metteur en scène, du chorégraphe, du scénographe et on peut les utiliser. Ce que je privilégie aujourd’hui, quand je parle du théâtre et que je l’enseigne, c’est d’expliquer aux gens que nous sommes à un tournant. Les étudiants de théâtre doivent comprendre que la forme évolue tout le temps et s’adapte aux réalités. Le théâtre classique est mort. Le théâtre contemporain c’est une interaction et une intelligence pour créer le lien entre deux nouveaux publics et de nouvelles façons de faire le théâtre.
Une partie du public gabonais et peut-être même africain vous a découvert à travers la ‘’Revue Noire’’. C’était un numéro spécial sur le Gabon, et dans le partie littérature on vous découvrait. Que pouvez-vous dire de cette revue aujourd’hui disparue, et surtout d’où vous venait l’inspiration de la nouvelle «Un parfum de grenades lacrymogènes»?

© Gabonreview
La Revue Noire a été une très belle expérience pour moi. Il faut dire que je jouissais déjà d’une réputation de dramaturge au Togo depuis 1988-1989. Et j’ai rencontré l’un des rédacteurs de la Revue, le Camerounais Simon Njami qui faisait un repérage sur la côte ouest-africaine, à la recherche de ce que lui-même appelait de nouveaux auteurs africains : la génération après Tchicaya U’Tamsi. Quand il arrive à Lomé, on lui parle de moi. On se rencontre, il me demande si en dehors du théâtre j’écris autre chose. J’écrivais des nouvelles, mais uniquement pour moi. Je ne les publiais pas.
En 1989, le mur de Berlin était tombé, les premières répressions politiques avaient commencé au Togo. Nous avions reçu les premières grenades dans les yeux à l’université quand nous voulions protester. Et j’avais écrit une nouvelle qui s’intitulait le «Un parfum de grenades lacrymogènes». Ce après avoir lu la biographie de l’écrivain japonais Yukio Mishima. Mishima, qui, à la fin de la seconde guerre mondiale, avait été très affecté par la disparition de l’Empire japonais. La reddition du souverain japonais était pour lui le déclin de la civilisation japonaise et le passage à une américanisation qu’il ne comprenait pas. Il voulait absolument que le Japon se rebelle contre la domination américaine et redevienne le pays d’antan. Il a donc essayé d’embarquer ses anciens frères d’armes dans une révolte. Ça n’a pas marché et, de dépit, il s’est éventré dans une caserne militaire pour protester contre la démission de toute l’armée nipponne devant l’Amérique. C’était vraiment impressionnant.
C’est un auteur que je lisais. Je découvrais ce fait spectaculaire et je me suis dit, dans un contexte comme le mien, le Togo où les artistes portent toujours en eux une protestation, qu’est-ce qu’un écrivain peut faire pour protester contre le système. Dans l’impossibilité de se faire entendre et de faire adhérer à son projet le peuple, comme on dit, ou d’autres frères d’armes, ils doivent faire comme Mishima. Ils doivent se donner la mort en forme de protestation. Et peut-être que sa mort pourrait réveiller les gens de la torpeur. Mais malheureusement, à la fin de la nouvelle, la vie a repris son cours normalement. Et c’est ce texte que j’avais remis à la Revue Noire. Iils ont publié et il va me permettre d’accéder à une nouvelle phase de mon travail d’écriture. Sortir du théâtre et aller vers la nouvelle qui va me conduire progressivement vers le roman. La Revue Noire a été une belle expérience.
Pour les Gabonais qui ne connaissent pas cette époque, on vient seulement de dépénaliser l’homosexualité dans leur pays. Et dans cette nouvelle, «Un parfum de grenades lacrymogène», il y a un gars homosexuel et qui l’assume. Comment les gens ont reçu ce genre de nouvelle ?
Très intéressant comme problématique. Il me fallait d’abord créer un personnage totalement marginal. Mishima lui-même était homosexuel. C’était très mal vu dans la société japonaise où le samouraï est viril. Le samouraï ce n’est pas une tantouze (rires). Mais Mishima avait un tel prestige comme écrivain qu’on fermait les yeux sur son homosexualité. Dans la société togolaise des années 89-90, l’homosexualité était déjà une question dans le milieu artistique. Elle préoccupait le politique. Ils n’arrivaient pas à gérer cela. Le paradoxe c’est que quand tu écris en 89 une nouvelle avec un personnage homosexuel, la première des réactions c’est : «Kagni, est-ce que toi-même tu es homosexuel ?» La question m’a été posée plusieurs fois. Je la trouve très intéressante parce qu’on voudrait croire que l’écrivain ne peut pas mettre en exergue des caractères sans lui-même avoir les caractéristiques de son personnage. Mais, ce n’était pas une histoire de vécu. C’est une reproduction de la vie de Mishima dans un contexte où l’homosexualité était – elle a toujours existé, mais le débat était naissant.
Oui, j’ai perturbé beaucoup de gens avec ce débat. Cela me fait rire parfois parce qu’il y en a qui ont gardé (rires) en tête les caractéristiques de mon personnage et qui continuent à le penser. Cela a donné lieu à quelques méprises, je le reconnais. Quand j’étais arrivé en France, tout jeune, pour mes études universitaires en 1992, cette nouvelle a créé beaucoup de malentendus parce que j’ai rencontré des gens qui croyaient que je l’étais. J’ai dû leur dire non. Mais dans l’imaginaire d’un écrivain, on peut être tout et rien à la fois.

© Gabonreview
Recevoir le prix Tchicaya U’Tamsi, c’est grisant, dopant ? C’est un booster ou ça peut faire dormir sur ses lauriers ?
Pour moi, ça été un booster parce qu’en réalité, l’essentiel du prix c’était une bourse d’étude pour aller en France et c’est ça qui m’a permis de m’inscrire au Conservatoire de théâtre de Bordeaux. Après, j’ai quitté le Conservatoire pour aller à l’université de la même ville. Cela m’a ouvert des voies et m’a mis dans un réseau théâtral que j’ai approfondi et pendant très longtemps. C’est d’ailleurs dommage que ce prix ait disparu, mais il est revenu à RFI.
Ceux qui avaient créé le Prix étaient eux-mêmes des écrivains. Il y avait la Malgache Michel Rakotoson qui était nouvelliste et dramaturge, il y avait la légendaire Monique Blin qui aimait beaucoup le théâtre à RFI et qui faisait produire le théâtre radiophonique ayant nourri l’imaginaire de beaucoup de jeunes dramaturges à l’époque. Il y avait une pratique et un réseau dans lequel on pouvait circuler qui allait jusqu’à New York… parce que mes premières pièces ont été traduites en anglais, représentées à New York. Dans le réseau francophone, le théâtre était ce qui circulait le plus dans ces années-là. Cela a débouché sur la création du Tarmac, le théâtre de la ville francophone de la Villette où énormément de jeunes Africains ont pu voir leur première pièce représentée alors que les théâtres fermaient en Afrique et que la pratique théâtrale issue des années 60 disparaissait peu à peu. Et aujourd’hui, pratiquement dans nos Etats, il n’y a plus de lieu pour faire du théâtre à part du happening, des performances, aller jouer dans des endroits qui ne sont pas des endroits conventionnels. C’est plaisant, ça forme les comédiens, mais ça ne les fait pas vivre, malheureusement. Il faut des lieux conventionnels à côté des lieux non-conventionnels pour que la profession puisse grandir.
(À SUIVRE)
.


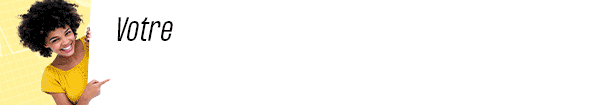





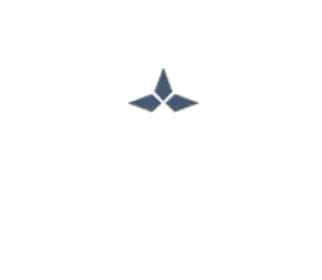







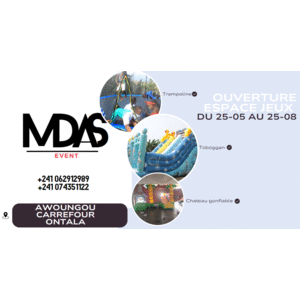
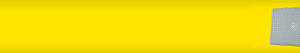

0 commentaire
Soyez le premier à commenter.