[Tribune] Les financements verts : panacée pour la conservation climatique ou nouveaux cycles d’endettement pour nos États ?

Expert financier, Thierry Biyogo* dresse ici un état des lieux critique des mécanismes de financement dits «dette contre nature», de plus en plus utilisés par des États comme le Gabon. Entre promesses environnementales et risques d’aliénation de souveraineté, il interroge les véritables enjeux de ces montages complexes orchestrés par des ONG internationales en partenariat avec la haute finance. Une analyse lucide qui appelle à la vigilance et à un encadrement rigoureux de ces nouveaux outils de financement vert.

Le risque d’hégémonie des ONG sur certains territoires, dans le cadre des programmes ‘dette contre nature’, n’est pas à exclure. Cela pourrait menacer la souveraineté nationale, avec des portions entières du territoire cédées à des organisations jouissant d’un quasi-droit d’usage illimité. © GabonReview
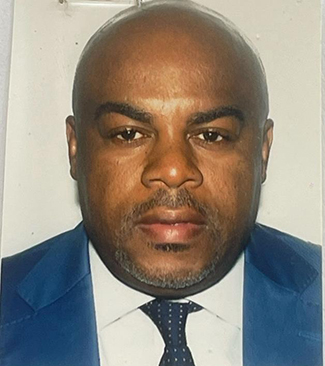
Économiste, Thierry Biyogo* est un expert financier, diplômé de l’ESG Finance à Paris et titulaire d’un MBA de la Strayer University à Washington D.C. © D.R.
À travers cette publication, nous proposons un regard lucide sur les nouveaux mécanismes de financement auxquels recourent certains États, notamment le Gabon. Dans une première partie, nous présenterons les mécanismes, les acteurs impliqués et les avantages annoncés. Dans une seconde, nous indiquerons les défis que posent ces nouveaux instruments financiers. Enfin, nous évoquerons les perspectives pour les pays concernés.
1) Les mécanismes d’échange dette contre nature
Après de longues décennies d’endettement, de nombreux États ont atteint des niveaux critiques où la dette devient un obstacle au développement économique et social. Il a donc fallu trouver des solutions innovantes pour alléger ce fardeau. C’est dans ce contexte que de nouveaux acteurs sont apparus : les ONG environnementales américaines, telles que Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), The Pew Charitable Trusts, Re:wild, The Wildlife Conservation Society (WCS) et le World Wildlife Fund (WWF).
Ces organisations ont mis en place des mécanismes ingénieux baptisés «échanges dette contre nature». Grâce à ces dispositifs, elles ambitionnent de mobiliser jusqu’à 100 milliards de dollars de capitaux privés, avec le soutien de la fondation philanthropique Zoma Capital.
Mais en quoi consistent concrètement ces programmes ? Le mécanisme d’échange dette contre nature vise à réduire la dette d’un pays en contrepartie de son engagement à financer des projets de conservation environnementale. Les créanciers acceptent alors de renoncer à une partie de leurs créances, et la valeur correspondante est réaffectée à des initiatives à fort impact écologique.
Ce type d’opération favorise la soutenabilité environnementale tout en allégeant la dette publique, contribuant ainsi à une meilleure stabilité financière des États concernés.
2) Les défis liés à ces nouveaux types de financements
L’émergence de ces mécanismes a fait apparaître de nouveaux acteurs : les ONG environnementales, désormais perçues par certains comme une forme de shadow banking — des banques de l’ombre échappant aux règles prudentielles classiques du secteur financier. Cette absence de régulation interroge, car ces ONG agissent en dehors du cadre bancaire traditionnel, ce qui place les États dans une position de dépendance face à elles.
Un autre défi tient aux relations étroites, voire ambiguës, entre ces ONG et les grands établissements financiers de Wall Street : JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, McKinsey, ainsi que des fonds d’investissement comme BlackRock ou Carlyle Group. Ces ONG bénéficient également d’un appui direct du gouvernement américain, via son bras financier, l’International Development Finance Corporation, qui garantit contre le risque politique toutes les opérations de levée de fonds, permettant ainsi l’accès à des taux préférentiels.
Dès lors, il est légitime de s’interroger sur le rôle réel de ces ONG. Sont-elles réellement indépendantes ? Peut-on ignorer que leurs conseils d’administration comptent souvent d’anciens dirigeants des institutions mentionnées, faisant ainsi planer un fort risque de conflits d’intérêts ?
La structuration même de ces financements soulève d’autres questions : qui en tire véritablement profit au-delà des États ?
En effet, les ONG empruntent à des taux inférieurs à ceux des dettes restructurées. Ce différentiel de taux leur permet non seulement de générer des revenus conséquents, mais aussi de couvrir les assurances liées à ces prêts. Une partie de ces emprunts sert également à constituer un trust fund — un fonds fiduciaire — placé sous leur contrôle exclusif, bien que contracté au nom des États concernés.
Ces fonds fiduciaires, généralement domiciliés dans des paradis fiscaux et placés sur les marchés financiers, génèrent des dividendes et des intérêts dont les ONG sont seules bénéficiaires. Ce déséquilibre paraît profondément problématique.
Par ailleurs, la durée du fonds est alignée sur celle du prêt, et l’actif n’est restitué à l’État emprunteur qu’à l’issue du remboursement intégral. À cela s’ajoutent les management fees, ou frais de gestion, que les ONG imposent aux États.
On le voit clairement : ces opérations, bien que présentées comme des actions philanthropiques, génèrent des bénéfices considérables pour les ONG qui les orchestrent.
Plusieurs pays ont déjà eu recours à ce type de financement :
- Seychelles : 21 millions de dollars
- Belize : 530 millions de dollars
- Barbade : 150 millions de dollars
- Gabon : 500 millions de dollars
La majorité de ces opérations ont été structurées par The Nature Conservancy (TNC).
Le cas du Gabon :
L’opération gabonaise concerne une restructuration de dette publique (en l’occurrence des euro-obligations) pour un montant de 500 millions de dollars. Cette opération a été financée par un blue bond émis par Bank of America, avec la garantie de l’US International Development Finance Corporation.
Ce refinancement a permis de faire passer le taux d’intérêt à 6,07 %, contre des taux initiaux allant de 6,625 % à 7 %, sur une durée de 15 ans. Les économies générées par cette réduction ont été allouées à la conservation marine.
Un fonds fiduciaire indépendant a été mis en place pour gérer ces ressources, dédiées à la préservation des océans gabonais. Toutefois, ce fonds est administré exclusivement par les ONG, bien que le prêt soit contracté au nom du Gabon.
3) Perspectives pour nos États
Si la conservation de l’environnement est une nécessité pressante pour nos États, les intentions affichées par les ONG environnementales — lever des fonds pour sauver la planète — restent louables. Toutefois, il est essentiel pour nos gouvernements de demeurer vigilants afin d’éviter de tomber dans un nouveau cycle d’endettement qui freinerait à nouveau leur développement économique et social.
Lever 100 milliards de dollars sur les marchés financiers peut sembler alléchant pour des pays vulnérables face aux changements climatiques. Mais à quel prix ? Le risque d’hégémonie des ONG sur certains territoires, dans le cadre des programmes « dette contre nature », n’est pas à exclure. Cela pourrait menacer la souveraineté nationale, avec des portions entières du territoire cédées à des organisations jouissant d’un quasi-droit d’usage illimité.
En conclusion, il revient à la puissance publique de trouver un équilibre entre l’indispensable rôle des ONG dans la préservation de l’environnement et la nécessité de défendre les intérêts nationaux. Cela passe par l’instauration d’un cadre législatif et réglementaire adapté, garantissant la souveraineté et la transparence dans l’usage de ces nouveaux outils de financement.
Thierry Biyogo*, expert financier, diplômé de ESG finance (Paris), Master in Business Administration (MBA) de Strayer Université, Washington Dc.


















0 commentaire
Soyez le premier à commenter.